
Divercity recrute !
Contexte : le dispositif Divercity
Depuis l’adoption en 2005 de la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (commerces, etc.) doivent être accessibles. Si des aménagements existent, ils ciblent encore majoritairement les handicaps visibles, en particulier les difficultés motrices (rampes, sanitaires adaptés, etc.). Or, 80% des handicaps ne se voient pas. Les troubles du neurodéveloppement (TND), qui concernent une personne sur six, font le plus souvent partie de ces handicaps.
Pour répondre à ces besoins, le Centre iMIND présente Divercity, un réseau de lieux adaptés aux personnes avec TND. Ces lieux ont été sensibilisés grâce à une série de capsules vidéo présentant les difficultés rencontrées par ce public. En mettant en place des aménagements simples et peu coûteux, les établissements recevant du public peuvent adapter leur accueil afin de favoriser l’inclusion des personnes avec TND.
Dans quelques semaines, une application mobile répertoriera les lieux ayant rejoint Divercity. Elle permettra aux personnes qui le souhaitent de repérer ces lieux plus facilement.
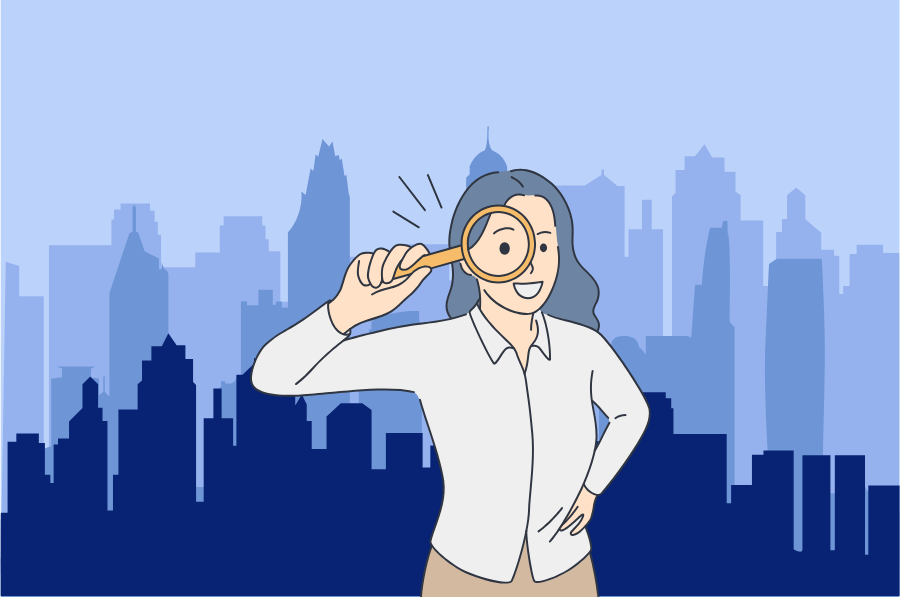
Déploiement sur le territoire
Afin que de nouveaux établissements rejoignent le réseau Divercity, une seconde phase de démarchage va débuter !
Pour ces deux offres, tu bénéficieras d’une formation dédiée au TND et à Divercity.
Postes à pourvoir : ambassadeur·rice·s Divercity
Profil recherché :
- Être majeur·e
- Aisance relationnelle et goût du contact : tu aimes aller vers les autres et échanger.
- Capacité à sensibiliser et à convaincre : tu sais adapter ton discours à tes interlocuteur·rice·s.
- Autonomie et esprit d’initiative
- Sensible aux questions d’inclusion
- Une connaissance des troubles du neurodéveloppement serait un plus, mais n’est pas indispensable
En binôme, tu seras chargé·e de :
- Aller à la rencontre des établissements recevant du public (commerces, restaurants, lieux culturels, etc.) pour les sensibiliser à l’accueil des personnes avec des TND.
- Présenter le projet Divercity et expliquer les bénéfices d’une meilleure accessibilité.
- Accompagner les établissements dans leurs premières démarches pour intégrer le réseau Divercity.
Points clés du poste d’ambassadeur·rice Divercity :
- Contrat : CDD de 3 mois à temps partiel (14h/mois)
- Durée hebdomadaire : 3h30/semaine
- Lieu : centre-ville de Lyon
- Rémunération : 148,78 € brut par mois
Le détail complet de l’offre se trouve sur la fiche de poste.
Pour candidater, envoie ton CV, une lettre de motivation et tes créneaux disponibles pour le poste (du lundi au vendredi entre 10h et 17h, plages de 3h30 minimum) à l’adresse suivante d’ici le 22 février 2026, en précisant dans l’objet « Candidature Ambassadeur·rice Divercity » : contact@divercity.app.
Poste à pourvoir : chargé·e de mission – relation avec les établissements
Profil recherché :
- Être majeur·e
- Aisance relationnelle et goût du contact : tu aimes aller vers les autres et échanger.
- Capacité à sensibiliser et à convaincre : tu sais adapter ton discours à tes interlocuteur·rice·s.
- Aisance rédactionnelle
- Autonomie et esprit d’initiative
- Sensible aux questions d’inclusion
- Une connaissance des troubles du neurodéveloppement serait un plus, mais n’est pas indispensable
En lien avec les ambassadeur·rice·s déployé·e·s sur le territoire et l’équipe d’iMIND, tu seras chargé·e de :
- Rechercher le bon interlocuteur au sein des établissements ainsi que ses coordonnées
- Contacter les responsables d’établissement par mail et/ou téléphone pour leur présenter Divercity
- Prendre des rendez-vous pour les ambassadeur·rice·s
- Présenter Divercity et expliquer les bénéfices d’une meilleure accessibilité (téléphone, mail, visio)
- Accompagner les établissements dans leurs premières démarches pour intégrer le réseau Divercity.
Points clés du poste de chargé·e de mission Divercity :
- Contrat : CDD de 3 mois à temps partiel (14h/mois)
- Durée hebdomadaire : 3h30/semaine
- Lieu : Campus hospitalier Le Vinatier (Bron)
- Télétravail possible après la phase de montée en autonomie
- Rémunération : 148,78 € brut par mois
Le détail complet de l’offre se trouve sur la fiche de poste.
Pour candidater, envoie ton CV, une lettre de motivation et tes créneaux disponibles pour le poste (du lundi au vendredi entre 10h et 17h, plages de 3h30 minimum) à l’adresse suivante d’ici le 22 février 2026, en précisant dans l’objet « Candidature Chargé·e de mission Divercity » : contact@divercity.app.
Recherche
Divercity est un dispositif innovant. C’est la première fois que des aménagements de ce type sont mis en place en conditions réelles. À ce titre, des projets de recherche ont vu le jour afin de valider la pertinence du dispositif et son impact sur la qualité de vie des populations concernées.
Une première étude (confiée au cabinet de design sociétal Mengrov) vise à évaluer les comportements des commerçants suite à la sensibilisation effectuée par les capsules vidéo.
Une deuxième étude (menée par l’Université Lumière Lyon 2) servira à vérifier l’acceptabilité des aménagements par les commerçants. Elle mettra en lumière les obstacles rencontrés par les commerçants, l’objectif étant de lever ces problèmes.
Enfin, trois études complémentaires (conduites par iMIND, le Vinatier et l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod) serviront à analyser les effets de Divercity dans un environnement urbain réel.
Poste à pourvoir : un·e post-doctorant·e en Sciences humaines et sociales, dont sociologie et psychologie (iMIND, Le Vinatier, ISC Marc Jeannerod)
Nous recherchons un·e post-doctorant·e afin d’évaluer le dispositif dans un environnement urbain réel au travers de trois études complémentaires :
- Étude 4a : Analyse des données d’usage générées par l’application
- Étude 4b : Évaluation en situation écologique de l’adéquation des aménagements aux besoins individuels
- Étude 4c : Étude longitudinale de l’impact du dispositif sur la qualité de vie des utilisateurs
Points clés du poste de référent·e scientifique :
- Statut : contractuel
- Spécialité/domaine : sciences humaines et sociales dont sociologie et psychologie
- Contrat : CDD
- Quotité souhaitée : temps plein
- Durée du contrat : 18 mois, prolongation possible en fonction des résultats obtenus
- Date de prise de poste souhaitée : premier trimestre 2026
- Lieu : Centre d’excellence iMIND (Campus hospitalier Le Vinatier, Bron, France), avec des déplacements dans la Métropole de Lyon à prévoir
- Télétravail : 1 jour de télétravail possible
- Salaire mensuel brut : selon grille salariale du Centre Hospitalier Le Vinatier
Sous la co-direction d’Amélie Soumier et de Marie Piéron et en lien avec l’équipe opérationnelle iMIND, le·la post-doctorant·e aura un rôle stratégique, en tant que référent·e scientifique des trois études. À ce titre, il·elle sera notamment chargé·e de :
- Concevoir et mettre en place les protocoles de recherche pour les trois volets d’étude :
- Définition des plans d’échantillonnage, méthodes de recueil de données, outils d’évaluation (questionnaires standardisés, mesures comportementales, enquêtes)
- Dépôt et suivi des démarches éthiques si nécessaire (CPP, RGPD)
- Coordonner la mise en œuvre des études en lien avec les partenaires scientifiques, hospitaliers et techniques du projet (Le Vinatier, iMIND, ISC Marc Jeannerod, Université Lyon 2, Mengrov)
- Assurer l’analyse des données, quantitatives et qualitatives, issues de l’application et des enquêtes (analyse statistique longitudinale, régressions, traitement de données complexes)
- Encadrer des étudiant·es en Master 2 ou en thèse de 3e cycle (1 par étude) tout au long du projet
- Produire les livrables scientifiques (rapports bimestriels, articles scientifiques, communications)
Profil recherché :
Compétences attendues :
- Expérience avérée avec publications dans la mise en place de protocoles de recherche, y compris en terrain écologique ou en milieu clinique
- Maîtrise des outils d’analyse statistique (R, Python, ou équivalents)
- La maîtrise des méthodes qualitatives serait un plus.
Connaissances :
- Familiarité avec les problématiques de neurodiversité, troubles du neurodéveloppement, ou accessibilité urbaine appréciée
- L’expertise d’usage est la bienvenue
Savoir être :
- Capacité de coordination
- Capacité d’adaptation
- Excellent relationnel
Le détail complet de l’offre se trouve sur la fiche de poste.
Pour postuler, envoyez votre CV, votre lettre de motivation et un ou deux exemples de publications ou rapports scientifiques à Amélie Soumier (amelie.soumier@isc.cnrs.fr) et Marie Piéron (marie.pieron@cnrs.fr) et Caroline Demily (caroline.demily@ch-le-vinatier.fr) avant le 20 février 2026.
Annonce iMIND
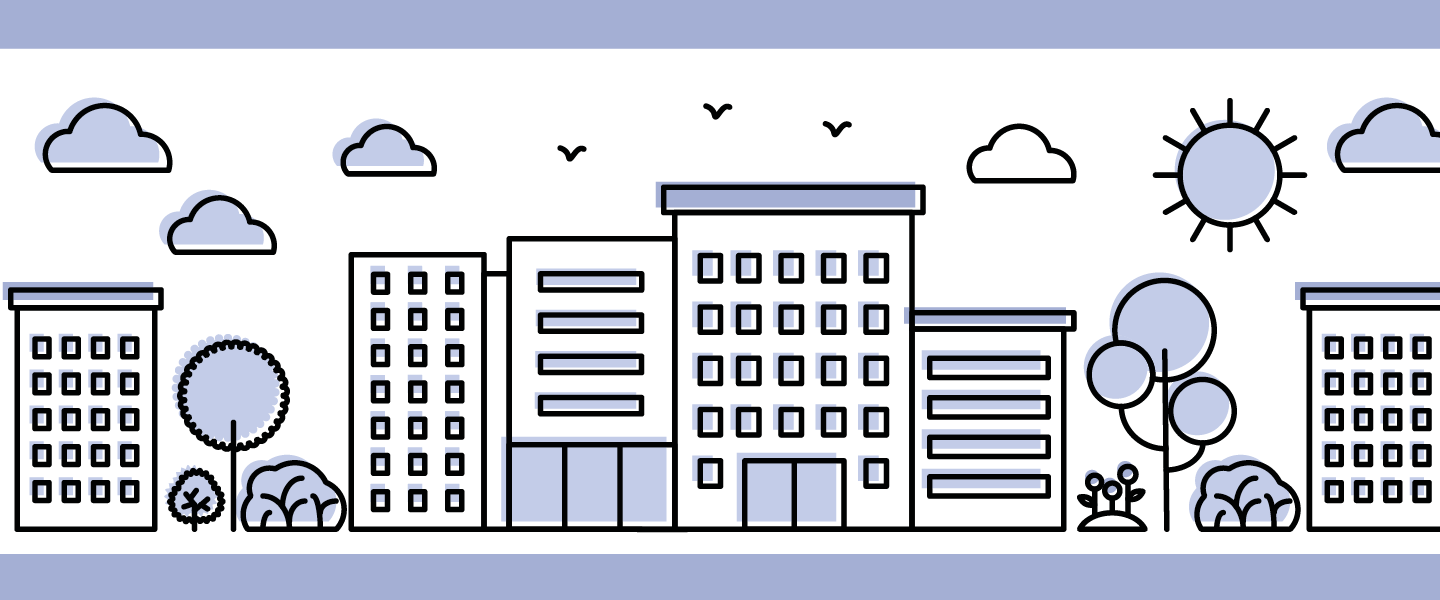
A lire également
Divercity
Avec le dispositif Divercity, l’objectif est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative.
En savoir plus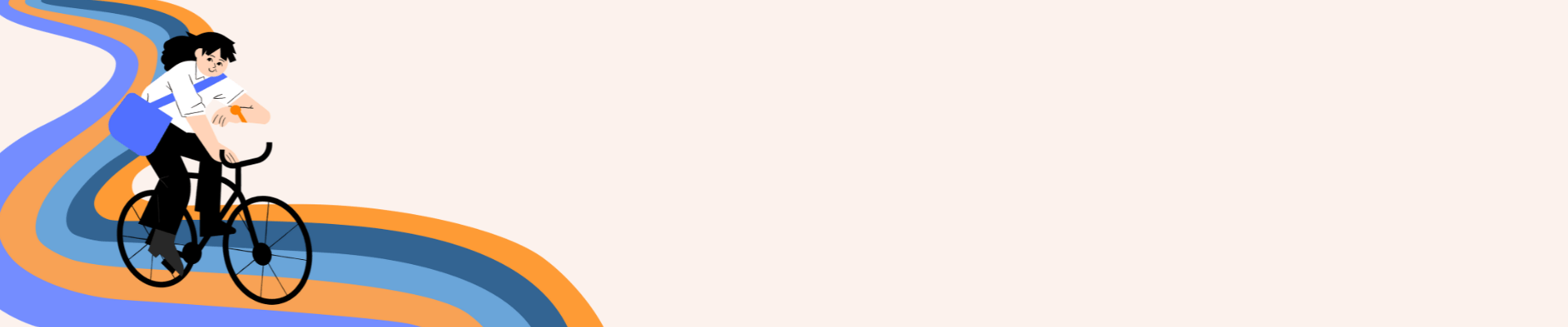
TSA et TDAH associés : compensation ou surhandicap ?
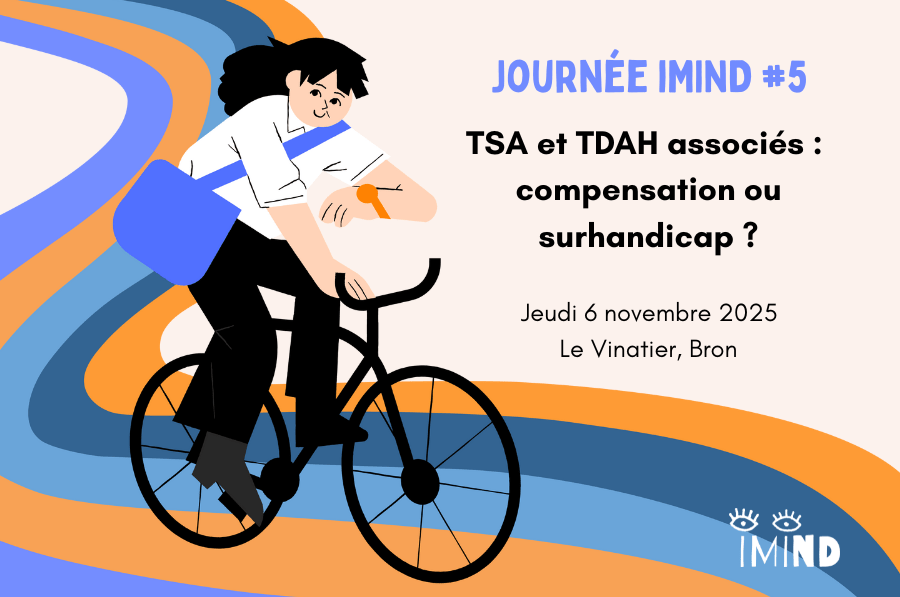
Présentation
Le Centre d’Excellence des troubles du neurodéveloppement iMIND vous a proposé une journée scientifique, gratuite et ouverte à tous·tes pour faire parler la science sur la cooccurrence du TSA et du TDAH et de leur diagnostic différentiel.
Aujourd’hui, la confusion est grande dans les limites entre le diagnostic de TSA, de TDAH et de leur cooccurrence. Nous avons exploré ce que dit la littérature scientifique du côté du diagnostic différentiel et de l’impact d’un diagnostic double. La seconde partie de la journée s’est davantage orientée sur les confusions entre le TDAH et ses comorbidités et le TSA. Enfin, nous avons accueilli un épistémologue, pour exposer les enjeux et les questions contemporaines existantes autour des TND.
Informations pratiques
- Date : jeudi 6 novembre 2025
- Lieu : amphithéâtre du Campus Hospitalier du Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, Bron
Replay
8h30 – Accueil café
9h – 9h15 – Introduction par le Dr Étienne Pot, délégué interministériel à la stratégie nationales pour les troubles du neurodéveloppement (en vidéo)
9h15 – 9h30 – Contexte actuel : confusions entre ces deux diagnostics et leur cooccurence – Lucile Hertzog (cheffe de projet TDAH et formation chez iMIND, CH Le Vinatier, autrice du site tdah-age-adulte.fr)
9h30 – 10h15 – Comprendre la comorbidité TSA-TDAH : état des lieux de la littérature scientifique – Pr David Da Fonseca (PU-PH, Marseille)
10h15 – 11h – TDAH ou TSA ? Comprendre pour mieux accompagner – Pr David Da Fonseca (PU-PH, Marseille)
11h – 11h15 – Pause
11h15 – 12h – Témoignage : retour d’expérience et expertise d’usage issus des deux diagnostics, mettant en lumière leurs impacts dans le quotidien – Stéf Bonnot-Briey, cofondatrice et coprésidente de la fédération AUTOP-H
12h – 13h15 – Paniers repas offerts (réservation dans le formulaire d’inscription)
13h15 – 14h – Comorbidité TDAH–TSA chez l’adulte : quand d’autres troubles viennent compliquer le tableau – Dr Louise Carton (PH, Lille)
14h00 – 14h45 – L’étude du retentissement des troubles associés TDAH-TSA – Dr Romain Coutelle (PH, Strasbourg)
14h45 – 15h – Pause
15h – 15h45 – Les troubles du neurodéveloppement et leurs enjeux épistémologiques contemporains – Dr Mathis Costes (philosophe des sciences)
15h45 – 16h – Clôture
