
Les personnes sans domicile sont-elles plus concernées par le TDAH ?
TDAH et sans-abrisme : une corrélation peu étudiée
Ne pas avoir de domicile fixe peut engendrer ou renforcer de multiples problèmes de santé. Curieusement, malgré le fait que l’on dénombre environ 150 millions d’enfants vivant à la rue dans le monde, les enfants et les adolescent·e·s sans domicile font l’objet de peu d’études sur leur santé et leur bien-être.
Nous avons interrogé la professeure Caroline Demily et le docteur Charles Denis, du pôle hospitalo-universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, qui se sont intéressé·e·s à cette question.

Tout a commencé par une observation de la Professeure Demily qui a été frappée par la présence importante de personnes sans domicile fixe (SDF) présentant des comportements évocateurs de troubles du neurodéveloppement (TND), tels que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou l’autisme. Elle évoque notamment une personne qui passait ses journées à écrire au sujet d’une planète. Cela a fait germer l’idée d’un projet de recherche. En effet, on sait que d’une part, les personnes SDF sont une population relativement peu étudiée et chez qui les troubles psychiques sont surreprésentés ; d’autre part, beaucoup de TND sont diagnostiqués de manière erronée et vus comme des troubles psychiques.
Partant de ce paradoxe, le pôle HU-ADIS du Vinatier a décidé d’étudier le lien entre absence de domicile fixe et TDAH chez les enfants et adolescent·e·s (Denis et al., 2025).
Le TDAH fait partie des TND. Il comporte des symptômes d’inattention et d’hyperactivité ou d’impulsivité. Il concerne environ 5,9 % des enfants et adolescent·e·s. Avoir un TDAH augmente d’ailleurs le risque d’être SDF un jour dans sa vie. Une étude s’étalant sur 33 ans a observé que les hommes ayant un TDAH ont entre 3 et 4 fois plus de chance d’être confrontés à la perte de logement que les autres hommes (Murillo et al., 2016).
Établir un lien entre avoir un TDAH et être SDF permettrait d’informer les clinicien·ne·s et les autorités afin de mieux accompagner les populations concernées. La prise en charge du TDAH nécessite un suivi régulier, ce qui est difficile d’accès pour les personnes SDF.
Comment les chercheur·euse·s ont-ils procédé ?
Les chercheur·euse·s ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse.
- Une revue systématique consiste à réunir le plus d’études scientifiques possible sur un sujet.
- Une méta-analyse consiste à prendre tous les résultats chiffrés de ces études afin de les mettre en commun.
Par ces deux procédés, les chercheur·euse·s limitent les biais car ils tirent leurs conclusions sur un large ensemble de cas. Mais pour cela, il a fallu établir certains critères de collecte afin de ne garder que les études pertinentes au regard du sujet.
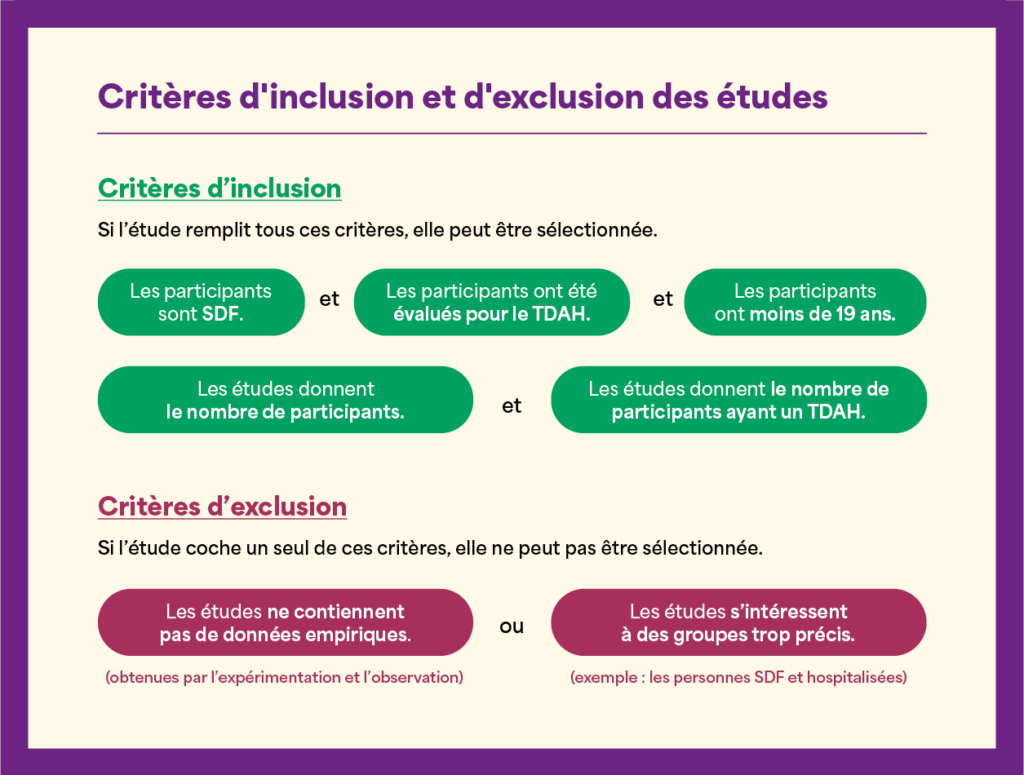
Il a donc fallu passer au crible de nombreuses études pour vérifier si elles répondaient à ces critères. Sur 391 études recensées, seules 13 ont été retenues. Les données ont ensuite été compilées.
La qualité des études a été examinée grâce à des grilles d’évaluation.
Une batterie de tests statistiques a permis de conclure ou d’attester que les différences entre les études n’étaient pas dues au hasard ni à des biais de publication ou de taille d’échantillon. En effet, les études sur une petite population ont parfois des résultats drastiquement différents par rapport à celles effectuées sur des échantillons plus larges, ce qui peut biaiser la fiabilité en donnant l’impression qu’un phénomène est bien plus fort qu’il ne l’est en réalité.
Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
La définition choisie pour le terme homeless n’était pas toujours indiquée dans les études. Or, en anglais, homeless peut faire référence à une grande variété de situations, allant de la plus extrême (le sans-abrisme, où l’on n’est pas hébergé du tout) au fait de ne pas avoir de domicile fixe (où l’on reçoit parfois de l’aide médico-sociale). Ces situations peuvent aussi évoluer dans le temps et être impactées par les différents dispositifs mis en place dans les pays. Les chercheur·euse·s ont donc fait le choix d’une définition la plus englobante possible, notamment du fait du petit nombre d’études.
De plus, la méthodologie utilisée pour recenser les cas de TDAH n’a pas été la même dans chaque étude. Souvent, des échelles de dépistage (moins fiables) ont été favorisées par rapport à des échelles diagnostiques (plus fiables), ce qui complique l’interprétation des données.
Qu’a-t-on observé ?
La méta-analyse a mis en lumière une grande diversité des résultats. Le pourcentage des enfants et adolescent·e·s SDF ayant un TDAH oscillait entre 1,6 % dans une étude népalaise (Ojha et al., 2013) et 64,5 % dans une étude canadienne (Labelle et al., 2020). En France, il était estimé à 2,4 % (Roze et al., 2016). Afin de concilier ces résultats, une moyenne pondérée a été effectuée, c’est-à-dire que l’on a pris en compte la taille des populations de chaque étude lors du calcul. Selon cette méta-analyse, la prévalence du TDAH atteindrait 22,8 % chez les enfants et adolescent·e·s SDF. Mais quel que soit le chiffre exact, il est bien supérieur à celui observé dans la population générale (5,9 % des enfants et adolescent·e·s).
Les chercheur·euse·s nous rappellent d’ailleurs que ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils indiquent plutôt une tendance qu’un résultat net en raison des différentes méthodologies employées.
Par ailleurs, on a observé que le paramètre ayant le plus d’impact sur la prévalence du TDAH chez les enfants et adolescent·e·s SDF était l’âge : on passe de 13,1 % d’enfants (moins de 12 ans) ayant un TDAH à 43,1 % d’adolescent·e·s (plus de 12 ans) ayant un TDAH. Les chercheur·euse·s pensent qu’un tel bond s’explique par l’environnement familial. En effet, dans toutes les études sauf une (Ojha et al., 2013), les enfants étaient à la rue avec leur famille tandis que les adolescent·e·s étaient seul·e·s.
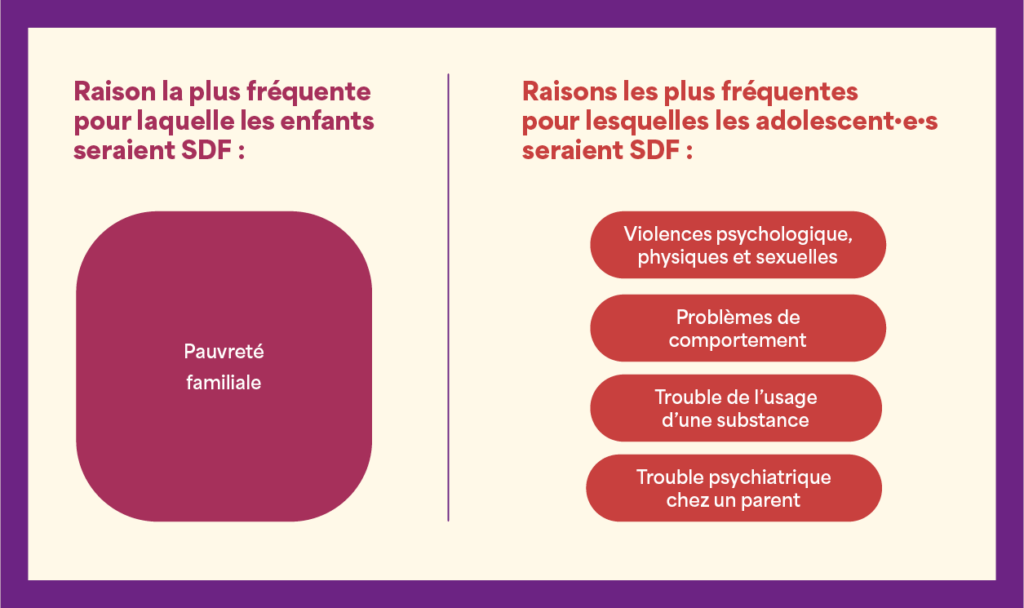
Certaines de ces raisons poussant les adolescent·e·s à la rue peuvent être liées aux conséquences d’un TDAH, ou bien participer au développement ou à l’exacerbation des symptômes d’un TDAH.
Y a-t-il des choses à mettre en place pour contrer le phénomène ?
Cette méta-analyse invite à prendre en compte l’absence de domicile et le TDAH de manière plus globale. En effet, d’un côté, le TDAH et ses comorbidités peuvent renforcer la probabilité de devenir une personne SDF ; de l’autre, l’absence de domicile fixe peut exacerber les symptômes du TDAH. Il semble primordial de chercher à diagnostiquer au plus tôt, d’autant plus quand on sait qu’un retard de prise en charge peut augmenter le taux de mortalité. Les personnes SDF accèdent difficilement à des soins de santé : les réintégrer dans le système de soin est impératif.
En France, il existe des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP). Or, selon la professeure Demily, elles ne sont pas assez formées aux TND. La lecture très « psychiatrisante » peut donner lieu à des erreurs de diagnostic : un TDAH pourra être pris pour un trouble de la personnalité, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourra être pris pour une schizophrénie. Selon elle, si l’on observe des problèmes d’addiction chez un jeune, la question du TDAH devrait systématiquement être posée (et il en va de même pour les difficultés d’insertion sociale, qui devraient au moins faire évoquer un TSA).
Le docteur Denis ajoute que ce manque de considération des TND est observé dans toute la psychiatrie adulte. Pour en arriver à la rue, « il y a souvent eu des ratés en amont ». Le passage à l’âge adulte est une période charnière pour les personnes ayant un TND, et on peut déplorer le manque d’accompagnements et d’aménagements.
Il faudrait donc développer les études de ce type, mais aussi s’intéresser aux trajectoires de vie pour identifier les ruptures de parcours.
Quelles suites pour l’étude ?
Le pôle HU-ADIS souhaite poursuivre ses recherches, cette fois-ci sur le terrain ! L’objectif sera de faire des évaluations diagnostiques chez des adultes SDF en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Comme ces personnes seront en CHRS, il sera plus facile d’effectuer un suivi et d’obtenir des résultats sur le temps long qu’avec des personnes sans-abris.
Trois TND seront recherchés : le TDAH, le TSA et le TDI (trouble du développement intellectuel). C’est donc une étude très ambitieuse qui se profile, mais qui permettra de poser un cadre théorique important. Il s’agira d’une première en France.
Ressources
- (Denis et al., 2025) Revue systématique et méta-analyse du pôle HU-ADIS au sujet de la prévalence du TDAH chez les personnes SDF
- (Labelle et al., 2020) Étude canadienne (prévalence de 64,5 %)
- (Murillo et al., 2016) Étude de 33 ans
- (Ojha et al., 2013) Étude népalaise (prévalence de 1,6 %)
- (Roze et al., 2016) Étude française (prévalence de 2,4 %)
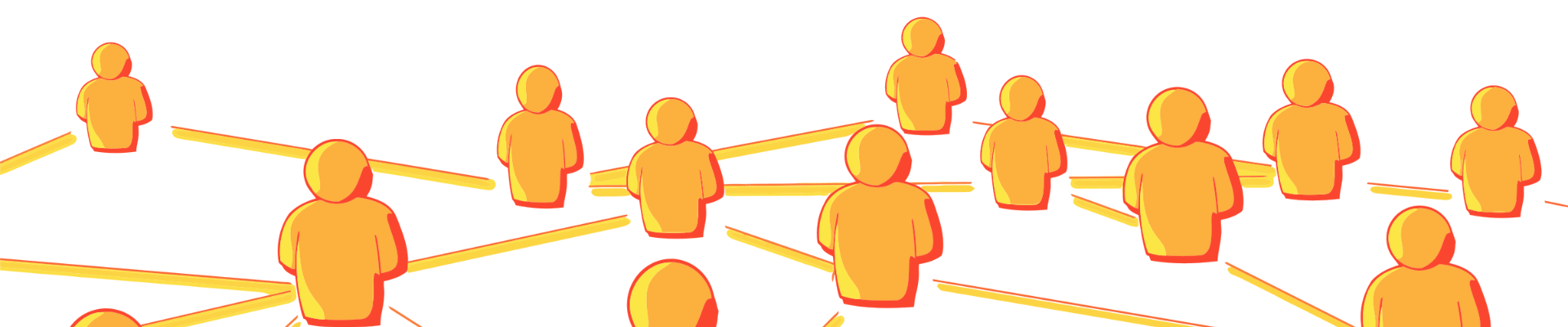
À la découverte de l'ÉCLAH
Le trouble du déficit de l’attention-hyperactivité (TDAH) touche 6 % des enfants et 3 % des adultes. Pourtant, la stratégie nationale 2023–2027 pour les troubles du neurodéveloppement souligne l’absence de filière de soin dédiée, des difficultés d’accès au repérage, au diagnostic et au traitement, ainsi qu’un besoin de formation des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire français.
Équipe de Coordination Lyonnaise des troubles de l’Attention et de l’Hyperactivité
L’Équipe de Coordination Lyonnaise des troubles de l’Attention et de l’Hyperactivité (ECLAH), créée en novembre 2023, est une équipe pluridisciplinaire visant à répondre à ces enjeux. Elle coordonne le réseau de soin, offre des formations, et propose des consultations spécialisées pour des cas complexes. L’ECLAH collabore avec divers acteurs pour structurer un réseau de soins, fournit des informations aux professionnels et aux institutions, et organise des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). Elle participe également à des projets de recherche sur divers aspects du TDAH.
ÉCLAH se distingue par sa mission de complément aux dispositifs existants, sans s’y substituer, en apportant une expertise spécialisée.
Informations pratiques
Lien utile : https://www.evolupsy-competence.fr
Contact : tdah[at]ch-le-vinatier[dot]fr
ATTENTION : les demandes adressées à l’ECLAH doivent obligatoirement provenir du médecin référent.
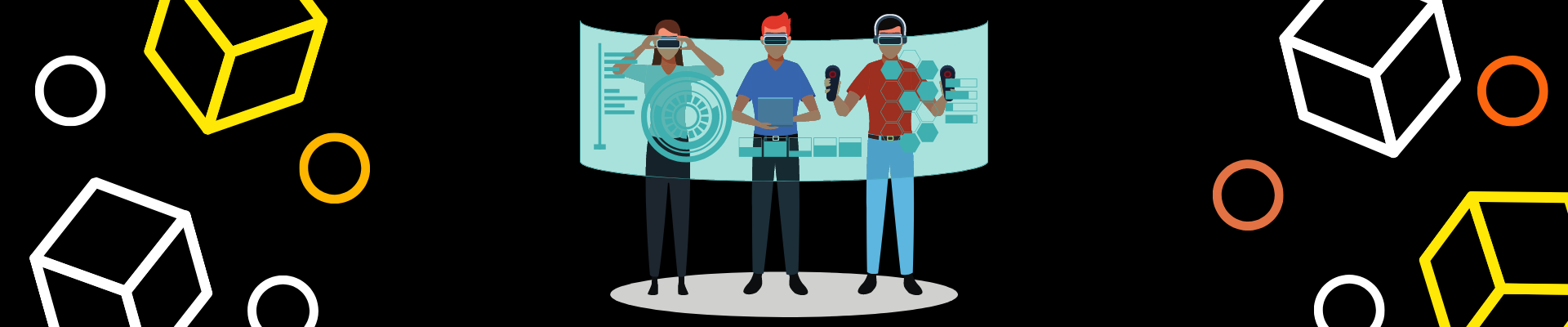
Par Jennifer Beneyton le 12/10/2021
Pierre Gadéa : "Transformer le soin en activité ludique"
Passer des jeux vidéos au soin, c’est un grand écart que Pierre Gadéa et son associé Romain Streichemberger ont réalisé avec succès en créant la Start-up, C2 Care. Nous avons interviewé Pierre pour en comprendre le cheminement et en savoir plus sur ce qui les anime aujourd’hui.
 Pierre Gadéa (gauche) et Romain Streichemberger (droite)
Pierre Gadéa (gauche) et Romain Streichemberger (droite)
Pouvez-vous nous raconter comment vous vient l’idée de C2Care ?
Mon associé et moi-même avions monté une start-up dans les serious games, en d’autres termes, c’est l’application des jeux vidéos à des domaines « sérieux ». On a trente ans et on est en quête de sens dans notre vie professionnelle. C’est là qu’on rencontre le Dr Malbos du service du professeur Lançon à l’hôpital de la Conception à Marseille qui nous raconte qu’il utilise la réalité virtuelle auprès de ses patients souffrant de TAG (troubles anxieux généralisés) depuis une dizaine d’année et qu’il a de bons résultats. Mais il a besoin de développer un partenariat avec une entreprise pour développer plus d’environnements virtuels. Avec Romain, nous sommes très emballés par le projet et c’est comme ça que C2Care est né.
Sur quels types de troubles travaillez-vous ?
Tout dépend de la structure avec laquelle nous travaillons. On évalue les besoins ensemble, le service établit un cahier des charges basés sur un protocole précis. Nous nous occupons de la réalisation technique et de la distribution. Au départ, nous avons commencé avec trois protocoles pour traiter les phobies les plus répandues : la claustrophobie, l’acrophobie (vertige) et l’aviophobie (avion). Puis les services d’addictologie ont commencé à s’intéresser à notre travail. Ils avaient besoin d’immerger leurs patients dans des environnements avec la présence potentielle de stupéfiants. C’était donc bien plus facile en réalité virtuelle. Puis, ce sont des neuropsychologues qui ont commencé à faire appel à nous pour leurs patients cérébro-lésés mais aussi les patients porteurs de troubles du neurodéveloppement dont des personnes TSA. Actuellement on développe trois axes : la remédiation cognitive, la remédiation psychosociale et la formation des professionnels de santé pour les mises en situation.
Comment mesurer l’efficacité de ces thérapies ?
Je suis lié par la confidentialité concernant les activités de recherche, mais les environnements que nous développons sont tous basés sur des protocoles qui nous ont été fourni par les CHU ou des structures spécialisées. Ils répondent à des critères scientifiques très précis et ont été évalués par des comités d’éthique. L’évaluation scientifique est une question primordiale pour les CHU. Avec C2Care, nous ne sommes pas dans le même espace-temps. Je comprends tout à fait le besoin des évaluations scientifiques pour valider ces pratiques et pour faire avancer la recherche, mais pour nous, l’important, c’est le retour des patients et des professionnels pour que nous puissions mettre notre travail à disposition des structures le plus rapidement possible.
Vous parlez de comité d’éthique, comment vous assurez-vous du consentement des patients ?
Nous avons travaillé sur cette question avec Gérald Debussy qui est neuropsychologue ainsi que le Dr Moreno: comment met-on un casque sur une personne qui n’est pas en pleine capacité intellectuelle ? Nous nous sommes rendus compte de la forte propension des patients à adhérer à ces pratiques, sans doute en partie pour le côté ludique du numérique. Certains montrent même de très fines capacités d’observation. C’était le cas d’un patient Asperger qui, au cours des tests de réglage, a observé un décalage infime de l’image que ni vous ni moi ne peuvent voir. C’était assez extraordinaire !
Pour les patients non-verbaux, nous nous assurons de la présence d’un éducateur ou d’un soignant qui connaît bien le patient et qui peut, à tout moment, nous alerter de son état. Je me souviens de cette séance d’exposition avec une personne non verbale, en fauteuil, qui s’est mis à hurler pendant le test avec le casque. Je me suis précipité pour lui enlever mais l’éducateur m’a arrêté : ces cris étaient en fait des cris de joie.
On sent vraiment que les patients sont au cœur de votre démarche.
Absolument ! Chez C2Care, notre volonté c’est de déstigmatiser la psychiatrie grâce au côté ludique de la réalité virtuelle et ainsi de contribuer à proposer des thérapies innovantes pour améliorer la prise en charge des patients et non pas la déshumaniser contrairement à ce qu’on pourrait craindre.
L’autre danger, c’est d’utiliser nos dispositifs en « occupationnel », c’est-à-dire, de mettre le patient dans un coin avec un casque, des heures durant, sans qu’il n’y ait de véritable projet thérapeutique. Je m’oppose fermement à cela. Nous n’avons pas vocation à être la télé de demain. J’y suis très vigilant lors de la construction du projet, mais en 6 années d’existence de C2Care, je n’ai rencontré que des personnes profondément humanistes, impliquées dans le mieux-être de leurs patients.
En ce moment, on parle beaucoup de santé mentale, selon vous, comment la réalité virtuelle peut-elle révolutionner la santé mentale ?
Je vais aborder la question plus largement en parlant du digital plutôt que de la réalité virtuelle seulement. Pendant très longtemps, la santé mentale a été très négligée au profit de la santé physique. Or on sait aujourd’hui qu’une personne sur 5 souffrira de troubles mentaux. On l’a vu pendant la crise du COVID. La santé mentale revient sur le devant de la scène et c’est grâce au digital que les relations patients-soignants ont pu être maintenues. En France, nous avons beaucoup de retard à rattraper. C’est ce que nous sommes en train de faire grâce à la rencontre de la recherche, de la santé et du numérique. Grâce à la réalité virtuelle, le soin se transforme en activité ludique.
Nous venons de développer une nouvelle activité chez C2Care. En effet, nous nous sommes aperçus qu’entre deux séances de thérapies, il ne se passe pas grand-chose pour certains patients. Nous avons donc mis au point un système de thérapie en stand alone contrôlé. Cela signifie que nous proposons un suivi psychologique classique grâce aux deux psychologues qui font partie de notre équipe, mais entre les séances, le patient peut s’entraîner sur un aspect particulier en réalité virtuelle via un casque que nous mettons à sa disposition. Les patients progressent plus vite et la psychologue peut suivre les exercices et l’évolution du patient pour adapter son suivi. Nous suivons actuellement 63 personnes alors que nous avons commencé en juillet 2021.
Nous n’inventons rien, mais nous travaillons d’arrache-pied pour améliorer les modes de prises en charge et évoluer vers la psychiatrie de demain.
+ ressources :
- Lien Méta-analyse Virtual reality exposure therapy for anxiety disorders: A meta-analysis – Mark B. Powers, Paul M.G. Emmelkamp.
- Lien Revue Littéraire Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders – Freeman.
- Lien Article L’utilisation de la réalité virtuelle dans le traitement des troubles mentaux – Malbos E et al.
- Lien Livre Blanc C2Care « La Réalité Virtuelle pour la Santé Mentale »
- Lien vers Vidéo présentation C2Care : Vidéo Eric Malbos et Vidéo logiciels C2Care
- Lien vers présentation générale C2Care
Newsletter

